Paul Jean Flandrin (1811-1902) La solitude.
Je poursuis donc, avec un petit détour qui aura tout l’air d’une sortie de route, mon raisonnement sur les « fanfaronnades » des chasseurs. L’autre jour, en traversant le fond d’une vallée particulièrement sombre, on apercevait ici et là des petites maisons isolées, juste au bord de la route, tristes comme tout, écrasées par l'immensité de la montagne boisée qui les surmontait.
- Qui peut vivre dans ce trou ?
- C’est vrai, pour supporter la vie dans ce trou il faudrait boire comme des trous.
- C'est le soleil intérieur.
Des maisons de cantonnier, peut-être, de garde-chasse, de forgeron, de meunier … derrière ces choix d’ermite il y a forcément une raison pratique. Je pense à la notion médiévale de « désert » : « Lieu déserté par les humains », et à celle de mélancolie : « Caractéristique dominante de quelque chose qui inspire de la tristesse ».
La nature sauvage est mélancolique. Et lorsque, perdu dans la verdure, on entend de loin le son d’une cloche, on est envahi par un sentiment de proximité, de restauration du lien social, de … « home sweet home ».
L’anthropologue Ernesto de Martino parlerait d’« appaesamento » : on aperçoit le clocher du village et le dépaysement s’arrête, on recommence à graviter autour d’un centre, on retrouve sa place dans un espace ordonné, un cosmos.
Pour ceux qui viennent juste de découvrir qu’il faut aimer la nature, bien intentionnés et porteurs des certitudes de la mystique néo-rurale, cela peut paraître scandaleux. Mais dans le silence obstiné des forêts, même l’écho d’une tronçonneuse peut résonner comme le son rassurant d’une cloche qui nous relie à l’humain : pas très loin il y a quelqu’un, on ne se voit pas mais cela suffit, on est là, on s’industrie … .
Et je reviens à la chasse. On dira que c'est indécent, mais un coup de fusil dans le silence automnal peut avoir le même effet sécurisant et apotropaïque qu’un tintement de cloche ou un bruit de tronçonneuse*. (à suivre)
* A fortiori en hiver, époque de l’année où les espaces boisés retrouvent leur autonomie et leurs habitants non-humains, visibles et invisibles, rétablissent leur souveraineté - Ce n’est pas moi qui le dis, c’est l’imaginaire folklorique. – Apotropaïque : « Se dit d'un objet, d'une formule servant à détourner vers quelqu'un d'autre les influences maléfiques ». (Larousse).
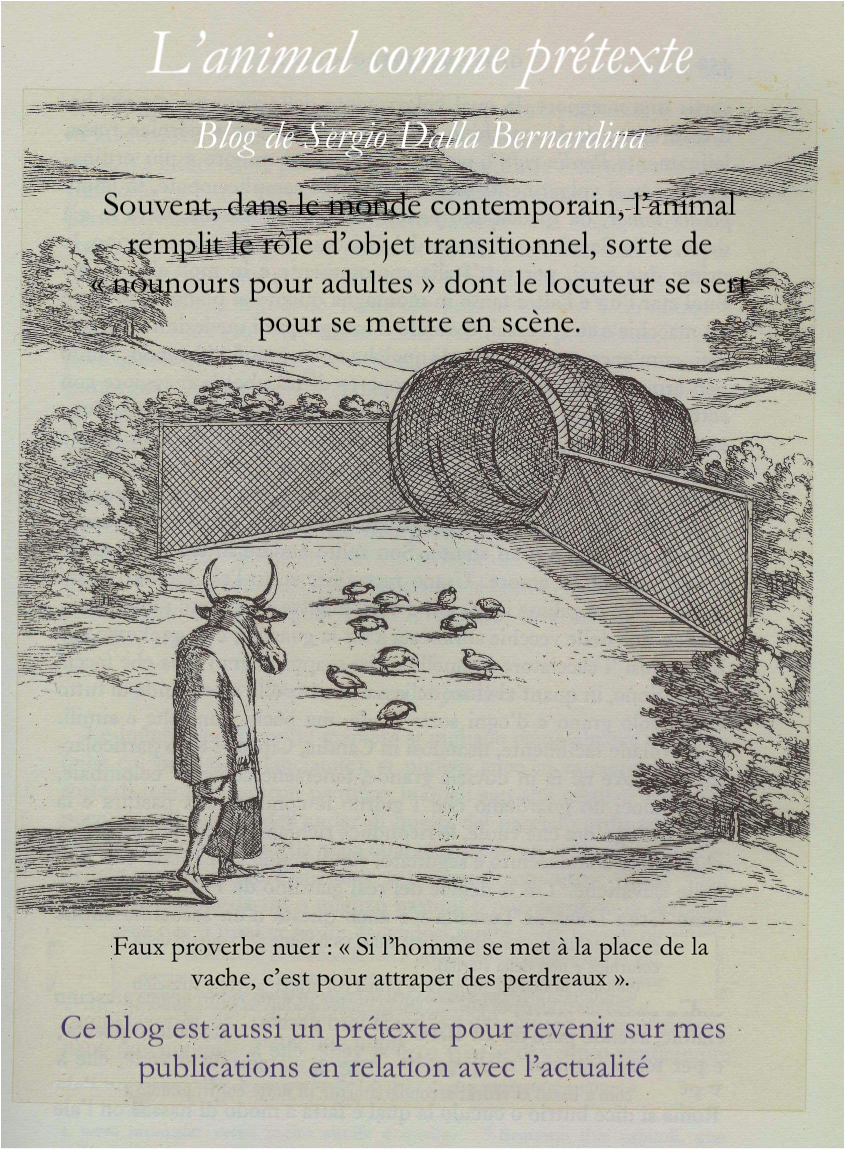

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire