Paysage fluvial très propice à la promenade avec son chien (Cliché SDB)
L’altérité des non-humains (la distance radicale censée les séparer des humains) est une construction sociale, je suis prêt à le reconnaître.
J’étais très proche de mon chien. J’ai passé ma jeunesse à me promener avec lui dans les champs, les bois et, lorsqu’on n'avait pas le temps pour s'éloigner, dans la broussaille qui longe le fleuve. On adorait tous les deux ces détours improductifs. La principale différence entre lui et moi, était que moi je disposais d’une maison, lui d’un jardin et d’un merveilleux chenil en dur avec tous les conforts d’un mobil-home. Il me semblait naturel que, en tant qu’animal, il vive dehors*. J’ajouterai que j’ai toujours ressenti une certaine antipathie pour les chiens casaniers et pantouflards.
Mais voici le problème : l’idéal de mon chien était la cohabitation et la porte d’entrée de la maison était vitrée. Le matin, lorsque je regagnais la cuisine pour préparer le thé, il était déjà sur place, le nez collé à la vitre. Je sortais et je le saluais affectueusement : « Tiens tiens, regardez qui est là. As-tu bien dormi, mon vieux ?». Je le caressais un peu, c’était plutôt une accolade, et je lui donnais quelque chose à bouffer.
Dès que je rentrais il commençait à gratter à la porte. Je sortais à nouveau et je lui disais : « Écoute … toi tu es un chien, moi non. Il faut que tu comprennes. T’as la chance d’avoir un jardin et un abri confortable ».
C’est inhumain, je le sais. Mais c’est comme ça. C’est très idéologique, mais j’ai le sentiment qu’un setter anglais qui vit à la maison trahit sa nature propre, son programme, sa physis, comme l'aurait dit Aristote*.
Hier matin, dans la pénombre, j'ai cru voir ses yeux qui me fixaient. Entre la porte vitrée et la cuisine, heureusement, il y a une autre porte qui normalement reste ouverte. Comme je le faisais lorsque mon chien était là, je l’ai fermée pour continuer mon petit déjeuner dans le calme.
* Moi aussi je suis un animal, je le sais.
** Pareil pour les setters irlandais. Je parle de mon chien au singulier, mais je devrais employer le pluriel.
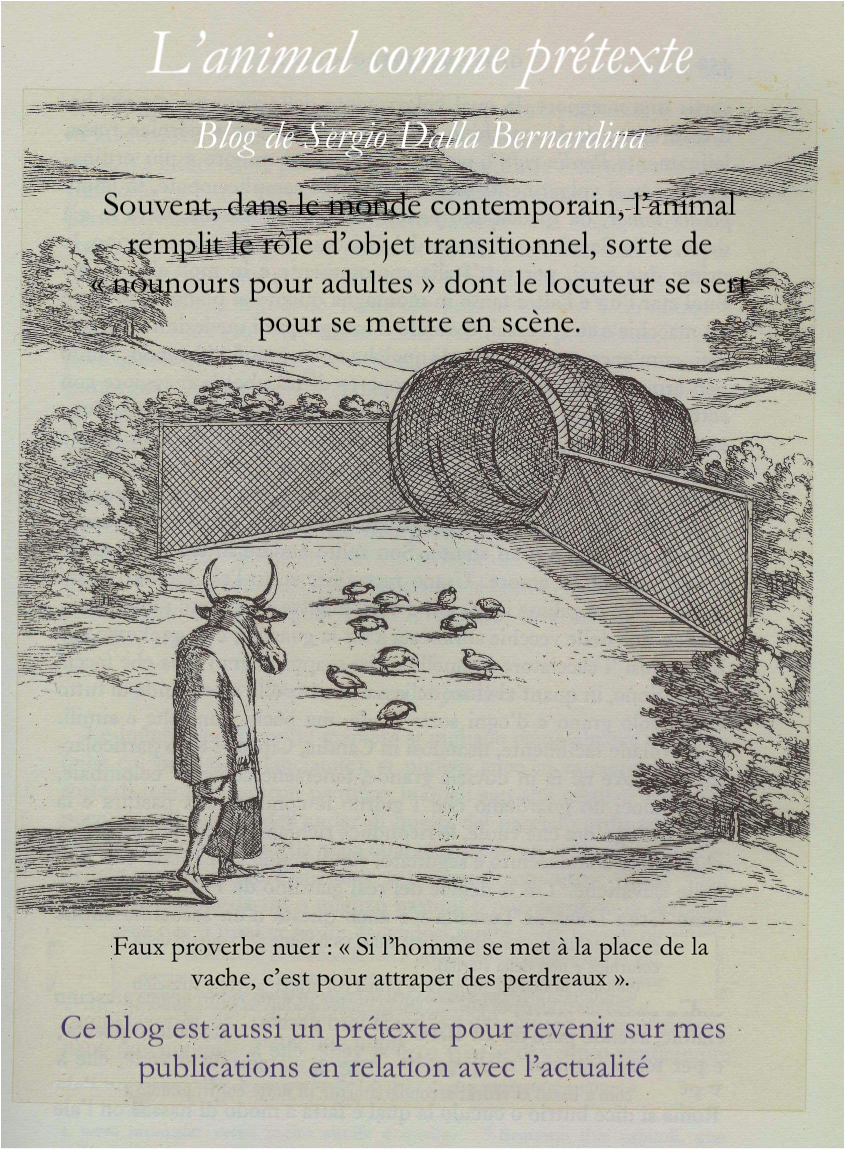

Les vivants manquent-ils aux morts ?
RépondreSupprimerArmelle Sêpa.
Je ne saurais pas généraliser. Mais chiens, en tout cas (enfin, je crois ...), traînent tous dans le jardin et m’attendent patiemment.
SupprimerLa première phrase me fait penser à … Simone de Beauvoir !
RépondreSupprimerNicole Juin
J’étais loin d’y penser. Mais j’ai un point en commun, effectivement, avec Simone de Beauvoir : moi aussi j’ai arpenté en long et en large la Sainte-Victoire.
SupprimerOn ne naît pas ethnologue, on le devient !
SupprimerCe clin d’œil humoristique à Simone de Beauvoir pourrait nous amener très loin. En tant qu’enseignants à l’université, nous passons notre temps à « construire » les nouveaux ethnologues. Cela s’apprend, effectivement : dans un métier comme le nôtre, l’imitation et la transmission « artisanale » jouent un rôle central. Pourtant, lors de nos stages didactiques de terrain, j’ai souvent constaté que certains étudiants — pas forcément les plus brillants ni les mieux dotés en capital culturel — semblaient posséder presque spontanément une « tête d’ethnologue ». Curiosité, sens du détail, empathie alliée à la capacité de prendre du recul, aptitude à saisir des problématiques locales tout en les mettant en perspective... comme s’il s’agissait d’un instinct.
SupprimerDe mon point de vue, c’est un peu comme pour la musique : on ne naît pas musicien, on le devient. Mais il est vrai que posséder l’oreille absolue peut grandement faciliter les choses.