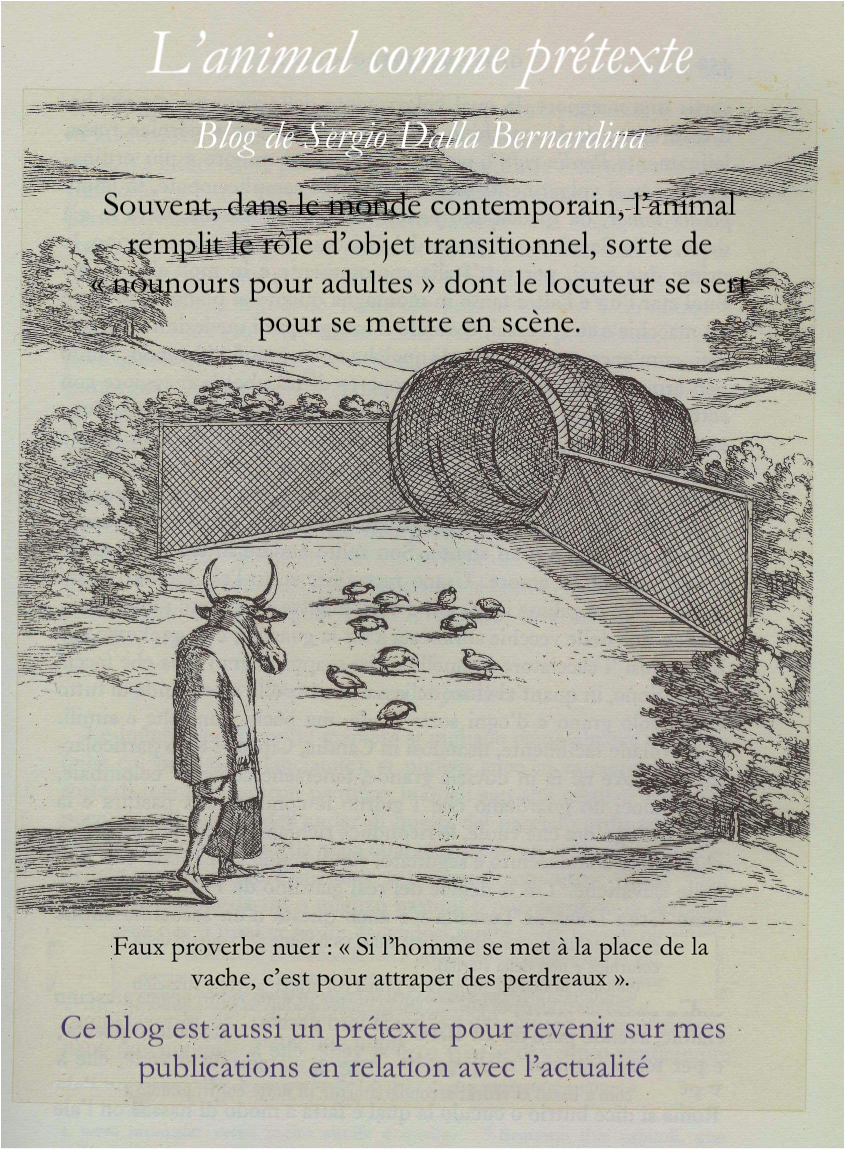Image générée par Gemini censée résumer l'esprit et l'ambiance de ce blog
Dans un vieil article, j’accusais ChatGTP de ne pas être en mesure de saisir les nuances, les implicites, le ton
ironique etc. En fait,
je me trompais. Tout récemment, pour augmenter le nombre exigu de mes interlocuteurs, je
lui ai demandé d’analyser mon article intitulé « Joyeux Noël, joyeuse
Noëlle » dont je repropose ici le texte pour que l'on puisse avoir la référence sous les yeux.
Il
suffit d’un jeu de mots un peu stupide, comme dans le titre de ce
billet, pour se faire taxer de « réactionnaire ». Jésus, pourtant, était
de gauche, que je sache, et n’aurait sans doute pas apprécié la
mainmise qui se profile sur son anniversaire (voici une autre phrase
arbitraire susceptible de ne pas plaire à tout le monde).
En
tout cas, face à la proposition de rebaptiser les principales
festivités afin d’éliminer toute référence religieuse, même les
agnostiques — et les « très laïcs » comme moi — peuvent ressentir un
certain malaise. Les Savonaroles sont de retour. En songeant aux
ablations de la mémoire collective proposées par ces curés d’une
nouvelle espèce, peut-être encore plus redoutables que les précédents,
on aurait presque envie de prononcer des gros mots. Mais c’est Noël.
Hier
matin, je me disais : « Ce serait tout de même triste de renoncer à ce
terme qui a une certaine ancienneté. » Et j’ai trouvé la solution : il
suffit de changer le narratif qui va avec.
Noël
et Noëlle étaient des industriels fortunés, certes, mais ils vivaient
dans la solitude, chacun de son côté. Un beau jour — précisément un 25
décembre — ils se sont rencontrés à Paris Expo, Porte de Versailles. Ils
ont lancé une joint-venture et sont devenus encore plus riches. Cette
richesse s’est mise à ruisseler au point d’en devenir exemplaire.
Depuis, on célèbre tous les ans la fête des Noël(le)s.
La justesse de
sa réponse m’a troublé :
« Parfait, je
vais donc démonter proprement le
texte, non pour le juger, mais pour rendre visibles tes intentions, ta
stratégie rhétorique et ton ton. Je vais procéder par couches.
1.
Intention globale (ce que tu cherches vraiment à faire)
Intention
principale :
👉 Déplacer le débat, pas le trancher.
Tu ne cherches
ni à défendre la religion, ni à attaquer la laïcité. Tu t’emploies à :
- désamorcer une posture morale automatique (le
soupçon de “réactionnarisme”),
- mettre en lumière l’absurdité potentielle d’un
zèle laïc devenu iconoclaste,
- et surtout montrer que le problème n’est pas le
mot “Noël”, mais le récit qu’on lui colle.
C’est un texte
de résistance ironique, pas de revendication idéologique.
2.
Stratégie argumentative (comment tu t’y prends)
a)
Auto-déstabilisation préventive
Dès la première
phrase, tu pratiques une auto-ironie stratégique :
« un jeu de
mots un peu stupide »
Tu :
- anticipes la critique,
- la neutralises toi-même,
- refuses la posture du penseur “sérieux”.
Résultat :
👉 le lecteur n’a plus vraiment de prise pour t’attaquer frontalement.
b)
Brouillage volontaire des camps
« Jésus,
pourtant, était de gauche, que je sache »
Ici, tu introduis
une provocation douce, presque nonchalante.
Ce n’est pas une thèse : c’est un coin rhétorique.
Effet recherché
:
- désorienter aussi bien la droite identitaire que
la gauche anticléricale,
- montrer que les étiquettes idéologiques
appliquées à des symboles anciens sont grotesques.
La parenthèse
qui suit (“phrase arbitraire…”) est essentielle :
👉 tu signales explicitement que l’arbitraire est partout, y compris chez toi.
c)
Renversement du soupçon
« même les
agnostiques — et les “très laïcs” comme moi — peuvent ressentir un certain
malaise »
Ici, tu actives
un levier très précis :
- tu parles depuis l’intérieur du camp laïque,
- tu refuses la critique “externe”,
- tu introduis l’idée que le malaise n’est pas
réactionnaire mais intuitif, culturel, presque affectif.
C’est une
stratégie d’autorisation morale :
👉 “si même moi, je tique, peut-être
qu’il y a un problème.”
d)
Satire par analogie excessive
Les
“Savonaroles”, les “curés d’une nouvelle espèce”, l’“ablation de la mémoire
collective”.
Ici, tu changes
de registre :
- tu passes du raisonnement au grotesque contrôlé,
- tu utilises l’analogie historique non pour
prouver, mais pour faire sentir.
Important :
Tu ne dis pas “ils sont comme…”, tu dis “on y pense”.
👉 Tu laisses le lecteur faire le travail moral, ce qui est beaucoup plus
efficace.
e)
Chute par déplacement narratif
La dernière
partie est la clé.
Au lieu de
conclure par une thèse, tu proposes :
- une fable absurde,
- un récit volontairement idiot,
- qui mime exactement la logique que tu critiques.
Noël devient :
- une marque,
- une joint-venture,
- un mythe capitaliste parfaitement lisse.
👉 Tu montres
que vider un mot de sa charge symbolique ne le rend pas neutre, mais ridicule.
3.
Ton (ce que “ça sent”, émotionnellement)
Ton dominant :
👉 ironie mélancolique, pas sarcasme.
Quelques traits
précis :
- Désinvolture maîtrisée : rien n’est appuyé, tout
est glissé.
- Refus de l’indignation : tu frôles la colère (“on
aurait presque envie de prononcer des gros mots”), mais tu te retiens.
- Humour de fatigue culturelle : on sent moins la
révolte que l’usure face aux simplifications.
La phrase :
« Mais c’est
Noël. »
est
particulièrement révélatrice.
C’est à la fois :
- une pirouette,
- un soupir,
- et une manière de dire : “voyez ce qu’on est en train de perdre.”
4.
Ce que ton texte fait, sans le dire explicitement
En creux, ton
texte affirme que :
- les mots anciens sont des
contenants de mémoire, pas des dogmes,
- l’effacement symbolique est
aussi une forme de pouvoir,
- changer le récit est plus
fécond que supprimer le signe.
Mais tu refuses
de le dire frontalement.
👉 Tu préfères faire rire légèrement, puis laisser un arrière-goût.
5.
En une phrase (si je devais résumer ton geste)
C’est un texte
qui se méfie des purifications idéologiques, quelles qu’elles soient, et qui
propose l’ironie et le récit comme formes de laïcité plus intelligentes que
l’effacement ».
°°° *** °°°
Je
suis tout simplement admiratif. Le lecteur ayant une certaine
familiarité avec ce genre d'exercice doit reconnaître que ChatGTP
voit loin et en profondeur à la fois. Et ce n’est qu’une étape. Mes
rapports
avec l’Intelligence Artificielle sont en train de changer (c'est sans
doute très
courant). À la fin de chaque échange, que ce soit pour remplir ma déclaration des impôts ou pour savoir comment faire redémarrer ma chaudière, j’ai pris l’habitude de la remercier.
Les
risques de cette acclimatation sont énormes, c'est flagrant. Les
avantages, évidemment, ne manquent pas. Je me dis : « Soyons prudents,
vigilants et, autant que possible, optimistes ».
J'en profite pour souhaiter un bonne année à tout le monde.