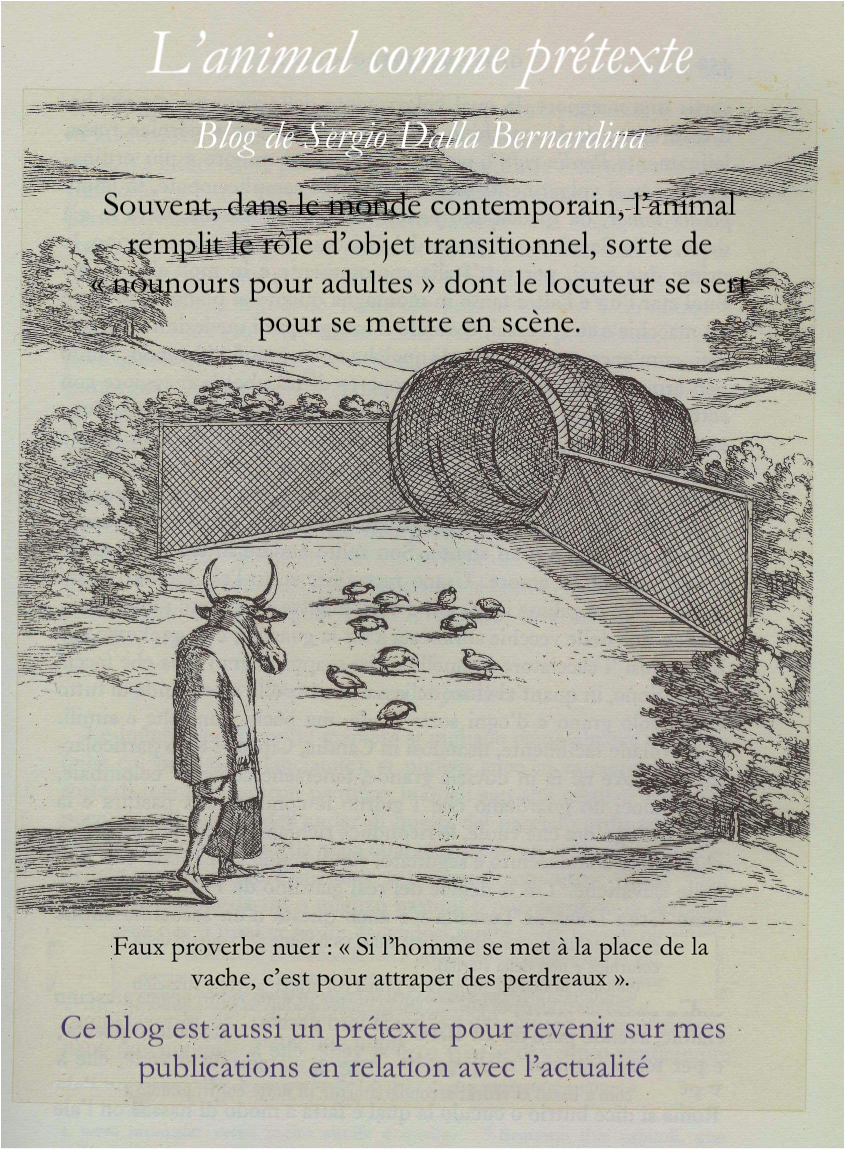Martin de la Soudière (à droite) dans les Hautes-Alpes en compagnie d'André, le berger-poète.
On parle beaucoup, chez les ethnologues, du retour du
sensoriel. « On a réduit trop longtemps le réel à ses structures
logico-symboliques et à ses
contraintes socioéconomiques », dit-on dans le milieu, « et aujourd’hui on redécouvre
l’importance des perceptions, des émotions, des affects ». C’est sans
doute vrai. Le problème est que le sensoriel, souvent, est traité par ses
« découvreurs » de manière scientiste, avec un jargon de
cognitiviste ou de vivisecteur. « Très juste, répond le « vivisecteur », mais
c’est pour rester dans le champ de la science. Il faut bien objectiver, pour
être scientifique. Quand on
subjective, on fait de la littérature ».
Lorsqu’on est touché par la grâce, cependant, on peut
conjuguer les deux. C’est le cas de Martin de la Soudière qui dans son récent ouvrage
« Arpenter le paysage »* arrive à croiser son expérience personnelle
(qui devient, dans le texte, l’expérience d’un acteur social particulièrement
bien renseigné) avec les théories et les pratiques du paysage d’une multitude
de peintres, d’écrivains, de géographes.Voici juste un passage reconstituant de l’intérieur, sans
faire appel à aucune catégorisation, l’ « empathie aussi soudaine qu’involontaire »
qui peut relier le voyageur « avec un endroit très précis, un coin de
campagne, une essence d’arbre (…) un type de temps aussi, ou avec une
saison … » :
« C’est, entre autres, pour cela que je m’y attache
depuis longtemps, y voyageant comme dans autant de paysages imprévisibles et
successifs. Soudain je ne vois plus qu’eux. Suffiront à faire l’affaire :
en novembre une matinée de demi-brouillard – un temps bleak, comme le dit la langue anglaise – à l’orée d’un
hameau ; un simple carrefour ou une croix de chemin ; une ferme
énigmatique ; un sentier sous la neige ; fin mai un pré de narcisses
blancs. Labiles, de nouvelles ambiances ont ainsi, régulièrement, le don et le
pouvoir de se lever, pour moi tout seul. Par surprise. Autre exemple, l’autre jour, pour une
fois j’ai même photographié : l’éblouissement soudain, le ravissement que
m’a procuré au petit matin la luminosité de l’hiver, le bleu cru du ciel
répondant alors à cet autre bleu-blanc dont se déguise la neige en montagne. Ce
jour-là, près du mont Mouchet, figés, parfaitement immobiles, silencieux,
émergeaient sur fond de sol enneigé, je ne voyais qu’eux, les troncs gris des
fayards (en occitan, le hêtre) et ceux de quelques maigres pins sylvestres (pas
de chênes, trop superbes et triomphants à mon goût) mangés de lichen, échevelés
et sans style, comme j’aime que soient les arbres. Ils semblaient (me) dire
quelque chose ».
*Martin de la Soudière Arpenter
le paysage. Poètes, géographes et montagnards, Paris, Anamosa, 2019, p.
238-239