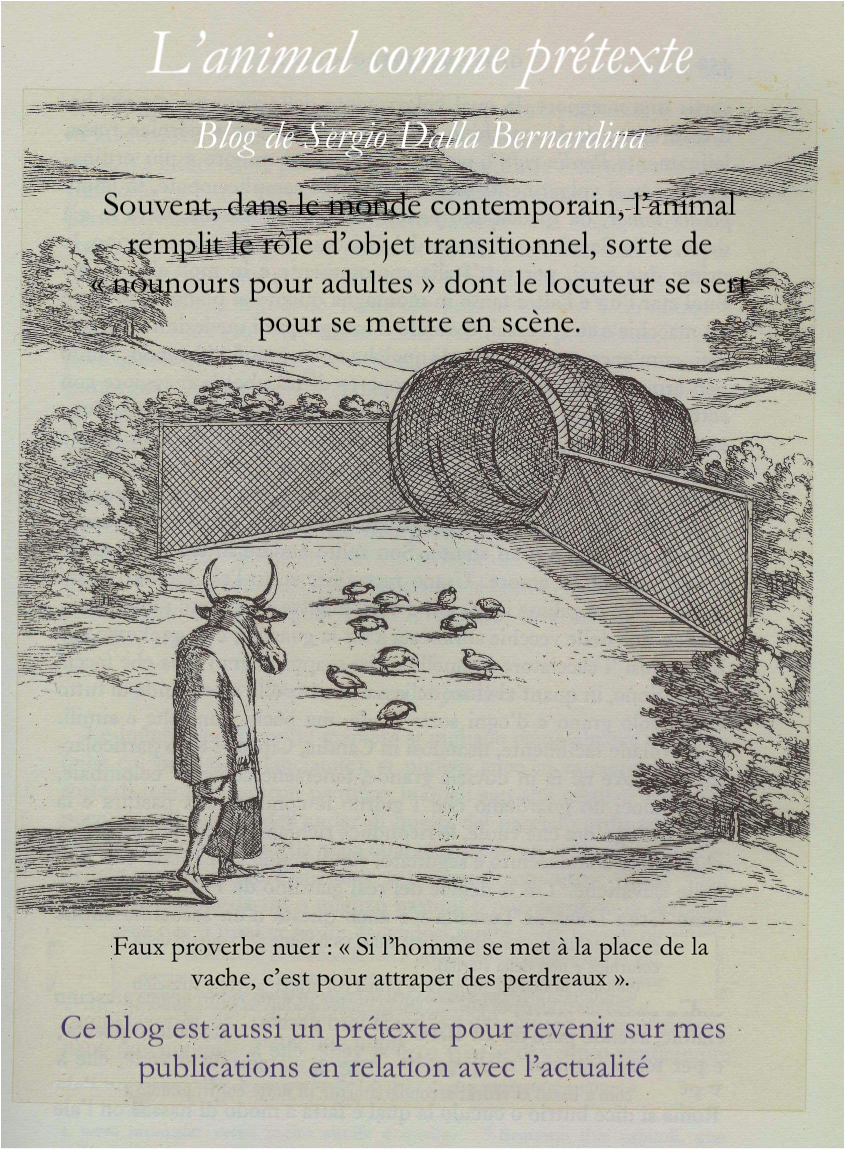Polémologie : Étude de
la guerre considérée comme un phénomène d'ordre sociologique.
Ce
que je viens de dire doit être interprété comme une sorte de contre-feu, juste
pour prévenir les critiques que l’on pourrait adresser à une anthropologie des
émotions, des passions et du sensoriel. Mais il va sans dire que chacun d’entre
nous, qu’il le veuille ou non, injecte dans son texte des contenus émotionnels et
cherche à transmettre aux lecteurs les sentiments de ses informateurs. Tout
texte, en ce sens, nous parle d’émotions. Le séminaire de l’année passée
s’était nourri, en grande partie, des articles d’un ouvrage collectif consacré
aux périphéries qui va paraître prochainement aux éditions du CTHS. Il
s’intitule À la lisière du monde. Pour une anthropologie des périphéries. Pour
le plaisir du jeu, j’ai relu quelques articles au prisme de notre question, en
me demandant ce qu’il y avait d’émotionnel dans les différentes contributions.
Qu’est-ce qui fermente dans le texte ? Quel est le motif de l’auteur ? Quel est
son mobile ? Quelle est sa « motion » ? C’est bien ce qu’on demande aux
étudiants qui s’inscrivent en thèse : « Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? »
Qu’y a-t-il d’intime et de passionnel derrière l’intérêt scientifique ? Mais on
aurait envie de poser la même question aux chercheurs chevronnés : « Pourquoi
travaillez-vous sans cesse depuis quarante ans sur la Comédie de l’innocence et
la mort de l’animal ? Ne seriez-vous pas un tantinet nécrophile sur les bords ?
»
Comme
je le rappelais, « motif », « mobile », « motion » et « moteur » sont des
termes qui dérivent du latin motus,
signifiant mouvement. Ils partagent leur racine avec émotion, ce qui nous amène
à un truisme : tout auteur est mû par une émotion. J’enchaîne
immédiatement avec un autre truisme : en dépit de son apparence aseptisée,
toute recherche, qu’elle soit théorique ou de terrain, est un entrecroisement
d’impulsions intimes qui alimentent le texte mais qui sont rarement déclarées. Puisqu’elles
sont de toutes sortes, dans ma rapide évocation de quelques interventions de
l’année passée je me limiterai à indiquer un mobile latent qui, bien que
largement connu, n’est pas souvent analysé en tant que tel : le mobile «
polémologique », c’est-à-dire celui de la confrontation avec le discours
courant ou avec ce que nos collègues soutiennent à propos d’un thème ou d’un
terrain. Oui, on n’écrit pas seulement pour défendre une lecture du réel. On le
fait aussi pour contrecarrer d’autres lectures qui ne nous plaisent pas ou qui
nous font concurrence. Je me limiterai à citer les articles où j’ai cru repérer
cette impulsion. Mais ce n’est qu’un antipasto,
comme on dit en italien, pour donner envie de jeter un coup d’œil à cet ouvrage
:
Dans
l’article de Martin de la Soudière qui ouvre le livre, cette impulsion est
presque évanescente et se réduit à la contestation de la notion de périphérie,
jugée, sur le plan heuristique, moins prometteuse que celle de marge. « Être à
la marge – je le cite – c’est se situer à l’extérieur de la norme, du pouvoir.
» Martin de la Soudière est un excellent ethnologue, mais il est avant tout,
selon moi, un écrivain. En ce sens, il fait de l’anthropologie des émotions
depuis toujours, sans besoin de le souligner, sans besoin de déclarations
officielles. Il est un peu comme Monsieur Jourdain, mais un Monsieur Jourdain
conscient de ce qu’il fait.
Dans
la contribution de Bernard Kalaora, l’interlocuteur explicite de cette
confrontation est le capitalisme et la société extractiviste. Chez lui,
l’émotion prend la forme d’une indignation à peine retenue : « L’espace océan –
écrit-il – malgré toutes les tentatives des puissances souveraines de le
privatiser, s’est toujours montré rebelle aux frontières ; sa nature fluide
reste réfractaire aux limites. » Il en va de même pour la forêt, autre haut
lieu de résistance aux forces qui cherchent à embrigader nos esprits.
Dans
la contribution de Raphaël Larrère, la confrontation théorique occupe une place
centrale, mais elle est présentée avec tant de simplicité et de fair-play qu’on
ne la voit pratiquement pas. Il s’agit de remettre en question l’existence même
de l’ordre symbolique censé structurer l’ontologie occidentale, axée sur le
binôme domestique/sauvage. On oublie trop souvent l’existence d’une troisième
dimension, le saltus des Latins, qui
ouvre sur des réalités hybrides qui ont toute leur place dans notre
organisation mentale et cosmologique. L’émotion y est latente et d’ordre
théorique.
Véronique
Dassié suit la même direction en signalant un vide dans le cadre de nos
disciplines et en nous rappelant à quel point la forêt, pendant très longtemps,
a été réduite par les anthropologues à un décor ou à une sorte de « non-lieu »
: « Les forêts européennes – écrit-elle – semblent en effet être ni assez
culturelles ni assez peuplées pour mériter pleinement l’attention
anthropologique, ce qui en fait finalement par là même des objets «
périphériques (…) ». Restituons donc aux forêts leur honorabilité.
Je
rappelais tout à l’heure qu’émotion et « moteur » ont la même racine. Chez
Agnès Tachin, qui nous a raconté une histoire de « vaincus » — les maraîchers
du Val de Saône poussés à s’installer à l’extérieur de la ville d’Auxonne au XVIIIᵉ siècle — le moteur de l’article est d’ordre mémoriel.
On dira que c’est normal chez les historiens, mais cela nous rappelle,
puisqu’on parle de mobiles et d’émotions sous-jacentes, à quel point le désir
de rétablir la vérité — d’arracher les souvenirs à l’érosion du temps — peut
alimenter, comme un feu souterrain, la scénarisation d’un texte. La cible de la
confrontation, ici, est constituée par les responsables régionaux, avec leur
penchant pour une patrimonialisation aveugle : ils patrimonialisent tout et
n’importe quoi, sauf le savoir des maraîchers qui ont pourtant joué un rôle
majeur dans l’histoire sociale du territoire.
Sophie
Bobbé n’est pas mue par des impulsions polémologiques, elle n’a pas de
catégories à défendre ni de comptes à régler. Elle nous décrit un cheval, avec
son accompagnateur, qui entre dans des chambres d’hôpital et qui soulage, par
sa présence, des patients gravement malades. La scène est aussi surréaliste que
dans un film de Buñuel. Pour ceux qui ont à l’esprit cette référence
folklorique, elle évoque Saint Nicolas qui entre dans les pièces des enfants
avec son âne pour leur livrer des cadeaux. Le cadeau, dans ce cas, est un
cadeau thérapeutique. L’émotion et le sensoriel sont vraiment au cœur de la
scène ethnographique, sans qu’il soit besoin de recourir à un jargon de
psychiatre, de neurologue ou d’hypnotiseur pour en rendre compte.
L’article
de Christophe Baticle s’intitule : « À la périphérie du “développement” en
Afrique centrale. Quand l’exploitation forestière et la protection de la nature
“dénaturent” les modes de vie locaux ». Même dans ce cas, la dimension
polémologique est évidente. Cette recherche s’inscrit dans une démarche
classique de nos disciplines : contester, par une recherche de terrain étayée
par des références scientifiques, la doxa officielle, un discours que même les
populations locales, influencées par ses représentants gagnés à la cause du capital,
finissent par accepter.
Sur
le plan des non-dits émotionnels, l’article d’Hugo Gassin va à peu près dans le
même sens : il dénonce la pression idéologique exercée par le pouvoir central
sur une autochtonie marginale et périphérique qui croit exprimer ses sentiments
et son expérience sensorielle du paysage local, alors qu’elle répète des
stéréotypes suggérés par les experts gouvernementaux.
Et
je terminerai en évoquant mon propre article, consacré au mythe du chasseur
écologiste. Son côté passionnel est déjà clair dans le titre : « La mémoire
courte. À propos des vertus du chasseur rural ». Le ton est sarcastique. J’en
veux à notre crédulité, à la manière dont nous acceptons volontiers des
relectures idéologiques du passé — des relectures fausses et opportunistes,
mais aux sons agréables, qui se glissent dans nos oreilles et s’installent dans
nos cœurs. Pourquoi les aimons-nous ? Parce que cela nous convient. Et leur
convenance nous émeut. Nous sommes, finalement, des redresseurs de torts — mais
des redresseurs de torts ambigus.
* J’en
profite pour rappeler que la question des « Passions ordinaires » et
donc des émotions du Français moyen,
avait été abordée et
problématisée dans un ouvrage collectif dirigé par Christian Bromberger,
Bayard, 1998).
**
L’urgence m’a empêché d’évoquer
tous les articles. À côté des contributions à qui je consacre ici quelques mots
on trouvera aussi, tout aussi précieux à mon avis : Karine,
Bonneval, « Phytokin » ; Christine Vial Kayser, « Giuseppe
Penone ou la matérialité du souffle » ;
Marieke Blondet, « Le retour de la périphérie ? Engouement montant pour
la forêt et alternatives forestières » ; Tangui Przybylowski, « La construction
des périphéries d’un patrimoine villageois wè-guéré : normes d’appropriation,
héritage de la guerre civile et litiges fonciers ».