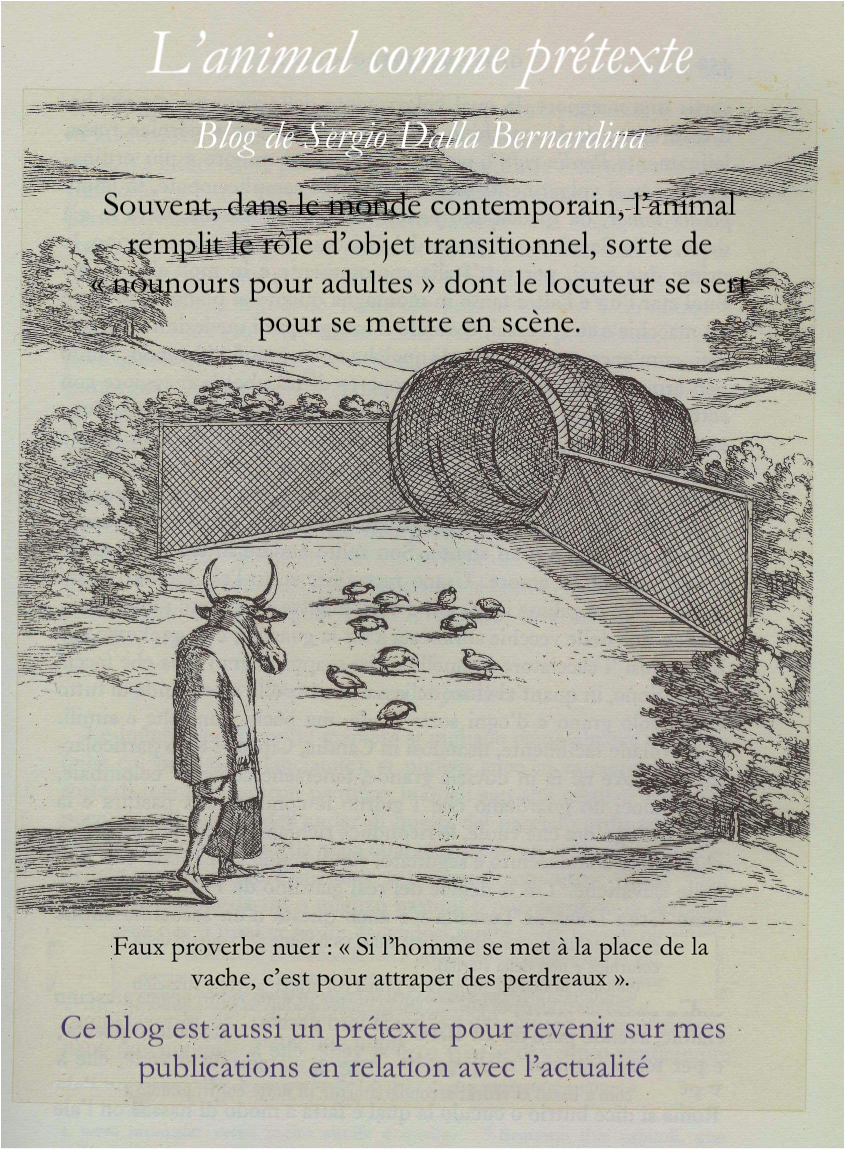Je relis un fragment d’un vieil article passé
complètement inaperçu. À l’époque je croyais encore que des propos de ce genre auraient
suscité une controverse. Personne n’a jamais réagi. Les Français disposent d'une formule
haute en couleur, concernant un violon et ses différents emplois, pour décrire l’inutilité de ce genre de
performances. Voici le passage en question :
« La bestialité a changé de lieu. La sexualité débridée du taureau, la violence
du loup, la soif de sang de la belette, la grivoiserie du porc, je dirais même
la puanteur du bouc, ont quitté le corps de la bête pour s’installer dans
d’autres corps, plus adaptés : ce sont, justement, les corps maladroits du
boucher, de l’équarrisseur et des autres « tueurs »:
« Je devrais vous parler encore
des horreurs qui entourent la mise à mort des bêtes de boucherie, les coups
d’assommoir mal assénés par des abatteurs improvisés et incompétents à moins
qu’ils ne soient ivres et indifférents à force de patauger dans le sang et de
donner la mort ». L’animal et …
nous ! Albert Jaumain, président de la société protectrice des
animaux, Bruxelles, Imprimerie Lucifer, 1946, p. 80
Il
en va de même pour les toreros. Dans les jeux carnavalesques décrits par
l’anthropologue espagnol Caro Baroja, la jeunesse des campagnes ibériques
persécutait avec enthousiasme chiens, chats, coqs, éloignés du cercle des
humains par des jeux cruels*. C’est avec une fougue comparable, que les jeunes
espagnols s’en prennent aujourd’hui aux derniers représentants de l’art
tauromachique, « chassés de la cité », comme l’étaient autrefois, à
la fin du carnaval, les masques des fauves incarnant la bestialité :
« (…) Torero tu es la honte d’une nation
Torero, tu es la violence à la télévision,
Torero, tu es assassin par vocation,
Torero, ton métier me fout la gerbe »
(refrain de la chanson « Verguenza »
- La honte – du groupe SKA-P, dans le CD Planeta
Eskoria)
Dans d’autres milieux, plus sophistiqués, les
remplaçants contemporains du « fauve » (et peut-être du
« faune ») d’antan sont les mâles de l’espèce homo sapiens :
« Il me semble que la ˝cruauté˝, -
ce qu’on appelle la cruauté et qui est inséparable d’un raffinement – est
spécifique de l’homme, de sa perversité, et peut-être aussi de la sexualité
masculine. », Elisabeth de Fontenay, « Entretien » avec Mario
Cifali, in La guerre et la pulsion de
mort, Chène-Bourg/Genève, 2003, p.
144.
Jean-Claude Nouët pousse jusqu’au but cette inversion
des représentations traditionnelles qui étaient centrées sur la méchanceté
innée de certains animaux, les prédateurs en particulier. Pour ce médecin,
ancien président de la Ligue française des droits de l’animal, s’il y a une espèce abritant dans son
programme génétique la commande de la cruauté – et il s’agirait de la seule –
c’est bien celle de l’homme **.
Dans ce genre de narrations
(« narrations » en ce qu’elles ont d’allusif, d’allégorique), la
réhabilitation de l’animal implique la stigmatisation, ou au moins la
« mise sous surveillance », d’une partie du genre humain. Si on
reclasse certaines catégories, c’est qu’on en déclasse d’autres ». (Extrait
de mon article : « Les joies du taxinomiste : classer, reclasser,
déclasser », in Aux frontières de l'animal. Mises
en scène et réflexivité, Annik Dubied, Juliet J. Fall et David Gerber éds. Droz, 2012
*Julio Caro Baroja, Le Carnaval,
Paris, Gallimard, 1979
**Jean-Claude Nouët, « L’homme, Animal inhumain » in (Georges Chapoutier éd.), L’animal humain, traits et spécificités,
Paris, L’Harmattan, 2004, p. 82-83