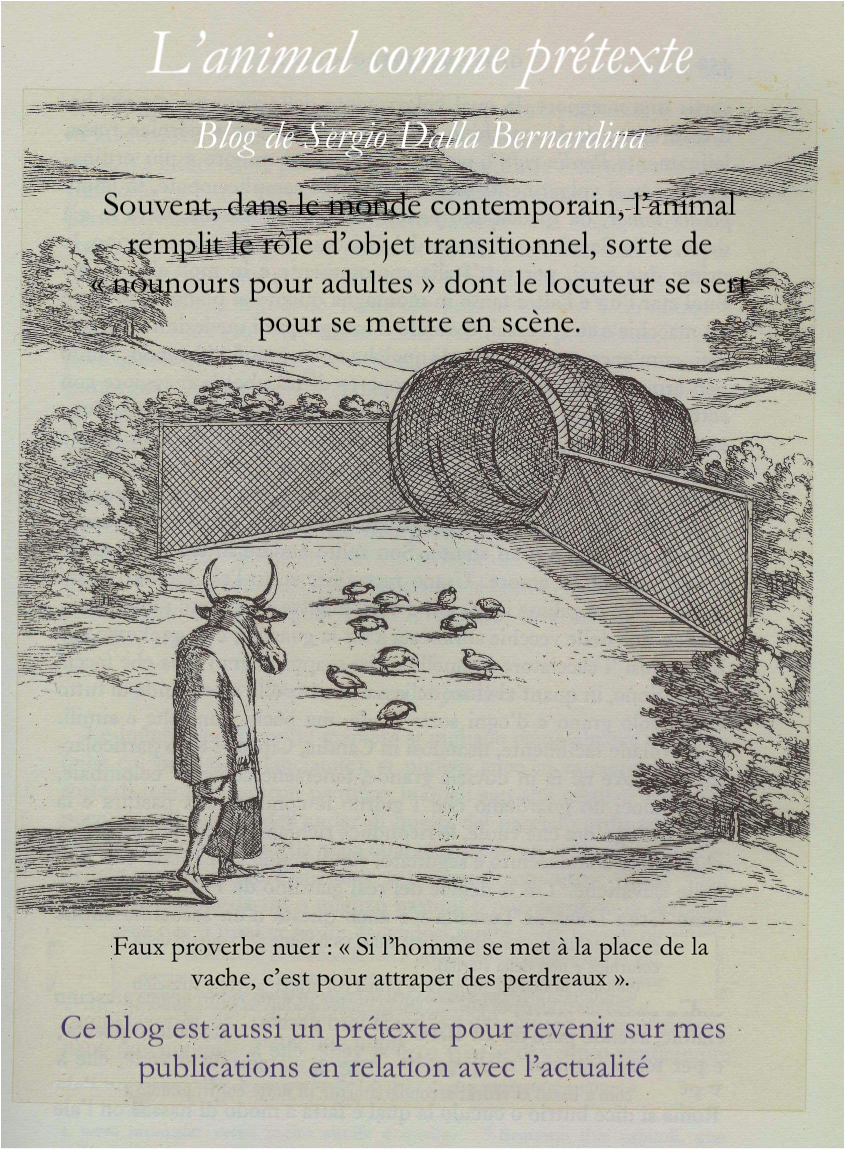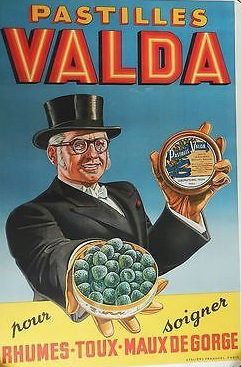Je suis parfois étonné de la
désinvolture avec laquelle les chasseurs contemporains se réclament de ces
« ancêtres mythiques » que sont devenus pour eux les chasseurs-cueilleurs. Leur
référentiel, assez souvent, est un
« chasseur-cueilleur pour philosophes », sorte de « bon
sauvage » déduit à partir de
ce que nous sommes. Et puisque
nous sommes des gaspilleurs et des ennemis de la nature, le « bon
chasseur d’antan » sera forcément un protecteur de l’environnement et un
ami des animaux.
D’autres lectures sont pourtant
possibles, qui n’emporteraient pas l’enthousiasme des porte-parole du
monde cynégétique qui cherchent dans le passé lointain, ou
dans l’exotisme, les arguments
pour anoblir le chasseur contemporain*. J’y pense en lisant ce passage
particulièrement insolite et intrigant, dans lequel l’anthropologue et
linguiste Glauco Sanga, nous parlant de la fable, de ses antécédents et de ses voies de propagation, compare les
chasseurs-cueilleurs aux marginaux contemporains :
« Quel rapport y a-t-il
entre les marginaux et les chasseurs ? Si nous comparons systématiquement
les caractéristiques de la culture des marginaux avec celles des
chasseur-cueilleurs nous trouvons des analogies surprenantes sur le plan
économique, environnemental, social, idéologique, psychologique. Les
chasseurs-cueilleurs n’ont pas un « mode de production » mais un « mode
d’exploitation », selon la définition de Meillassoux (…), alors que
l’agriculture, l’élevage, l’industrie, « produisent » les ressources,
la chasse et la cueillette « prédatent » [exercent la prédation
sur] les ressources existantes : « L’homme puise tout ce qui lui sert
dans la nature sans l’améliorer ni la modifier » (…). Les marginaux, de la
même manière, se procurent leurs ressources par la prédation, non pas dans
l’environnement naturel mais dans l’environnement social : le vol et la
fraude (homologues de la chasse avec des armes et des pièges) et la mendicité
(homologue de la cueillette). La mendicité (comme la cueillette) est individuelle,
tandis que le vol et la fraude (comme la chasse), peuvent prendre des formes
coopératives. Le temps consacré à la prédation, parmi les marginaux comme parmi
les chasseurs-cueilleurs, est dans son ensemble limité, mais irrégulier, et présente
cette allure fluctuante, assez caractéristique, que Sahlins a défini le « rythme paléolithique ». (…). Les ressources, même si elles
peuvent parfois abonder, sont aléatoires. Aucune forme d’accumulation de la
richesse n’est pratiquée ; il s’ensuit un régime de fluctuation
existentielle où l’on voit s’alterner les périodes d’abondance et celles de
pénurie. Sur le plan environnemental les marginaux, comme les
chasseurs-cueilleurs, pratiquent également le nomadisme, c’est à dire la dispersion
territoriale pour pouvoir exploiter les ressources selon la logique de la rotation ; et en
montrant une grande capacité d’adaptation à l’environnement, qui n’est pas
modifié mais parasité. Même sur le plan social les marginaux présentent la
caractéristique typique des chasseurs-cueilleurs, c’est à dire la flexibilité
des groupes sociaux : le groupe fondamental est la bande, une agrégation
souple et instable reliée à l’exploitation des ressources. Il y a une forte
idéologie solidaire et égalitaire ; le produit du vol (comme celui de la
chasse) est équitablement partagé par le groupe. À l’instar de la chasse par
rapport à la cueillette, le vol et la fraude sont valorisés par rapport à la
mendicité, comme sont valorisées l’intelligence, l’habileté, l’astuce, l’audace
et la capacité de s’exposer au risque, ainsi que la liberté et l’absence de
contraintes. Pour finir, on retrouve, aussi bien chez les chasseurs-cueilleurs
que chez les marginaux, l’immersion dans le présent (le fait de vivre au jour
le jour) ; l’aversion pour le travail (en tant que contrainte, discipline,
obligation) ; la propension à l’oisiveté, à la dépense, à l’excès ;
un fort sentiment identitaire et de supériorité qui, dans le contact avec les
populations qui produisent, engendre une idéologie de l’inversion des valeurs
(le « monde à l’envers) et une opposition systématique des deux
mondes : les marginaux opposent les droits aux gagi [les paysans perçus comme des poulets à plumer], comme les
Pygmées Mbuti opposent la forêt au village » (…). Glauco Sanga, La fiaba. Morfologia, antropologia, storia. Padova,
CLEUP Università di Padova, 2020, p. 268-270**. Je reviendrai sur cet ouvrage,
probablement.
*Je rappelle que je n’ai rien contre
le chasseur contemporain. Je n’aime pas trop, cependant, le chasseur
fanatique ou obtus (il y en a quelques uns). Je parle de celui qui ne tolère pas l’ironie, qui pense que
pour valoriser la chasse il faut cacher les évidences fâcheuses, qui aime
seulement les analyses partisanes brossant le chasseur dans le sens du poil.
** Ma traduction un peu hâtive.