Après, tout est allé très vite : le diamètre du tronc du noyer a manifestement dépassé celui de mon crâne. Le danger était donc écarté. Mais une vague noirceur, juste un soupçon au départ, s’est mise à concurrencer l’éclat du feuillage. Mon noyer, à son tour, était couronné. Il n’a pas porté sa couronne pendant longtemps. Deux années plus tard il était mort sur pied, raide et déséquilibré comme un épouvantail courbé par le vent. Pour faire le deuil, j’ai procédé à la manière d'un démiurge : « Moi je t’ai planté, moi je te déplanterai ». Je suis monté sur l’arbre muni d'une scie et patiemment, pièce par pièce, je l’ai aidé à libérer l’espace jardinier de sa présence borderline.
À la fin de la cérémonie ne restait sur scène qu’un massif
de millepertuis voulu par ma mère pour « faire gai » (« Quanto verde, Sergio, sembra la
foresta vergine … »). J'ai contemplé mon œuvre avec un regard de paysagiste. Tout était rentré dans l'ordre, comme si la plante n'avait jamais existé. Un ordre de cimetière qui, au lieu d'endiguer l'entropie, l'accentuait tout en la dissimulant.
Mais non. Un panache anomique sortait timide du massif. C’était un noyer tout jeune. Il souriait. Je l'ai accroché à un tuteur*, j'ai réduit le millepertuis pour lui faire de la place et voilà ... c’est comme si je l’avais planté moi-même.
* Il semblait déjà pencher, légèrement, vers un vide générique.
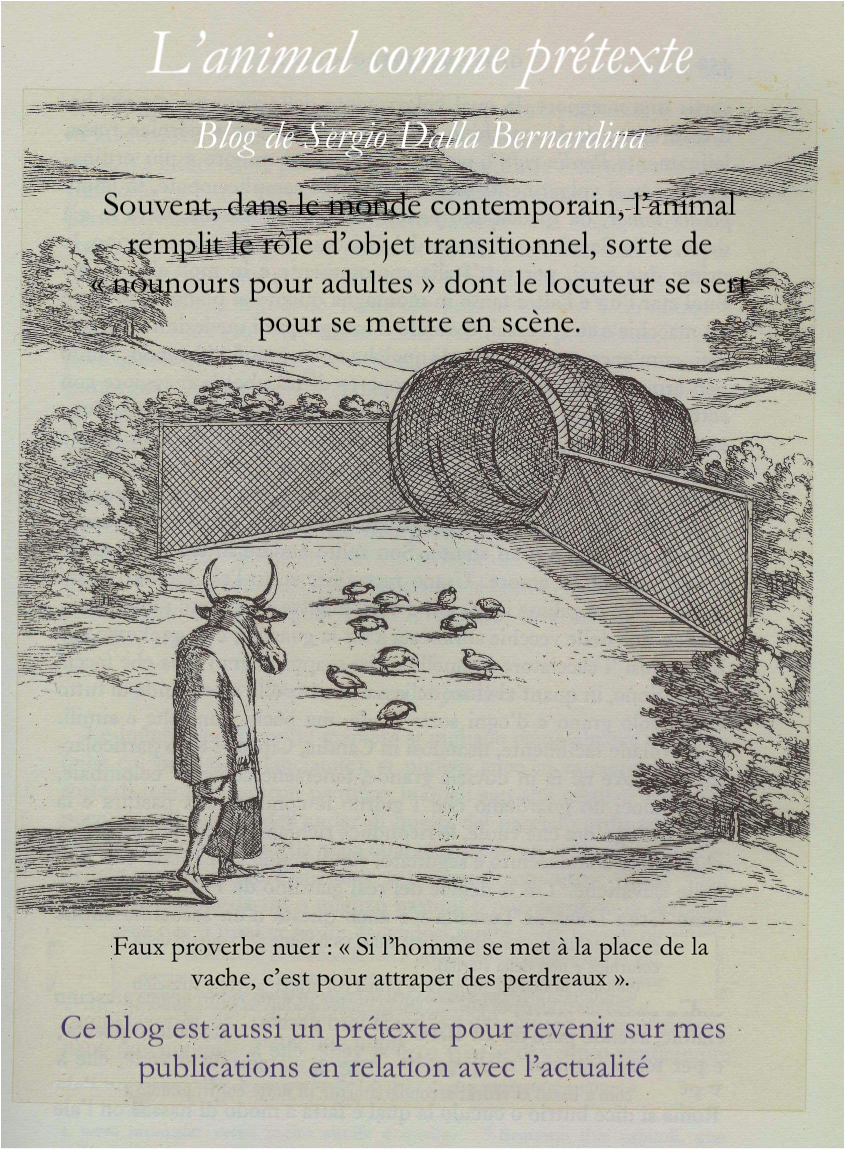

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire